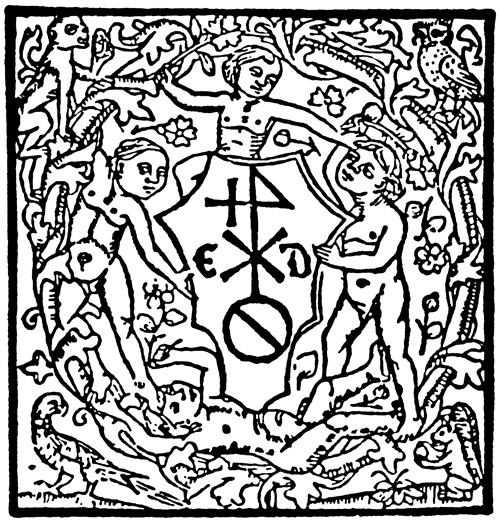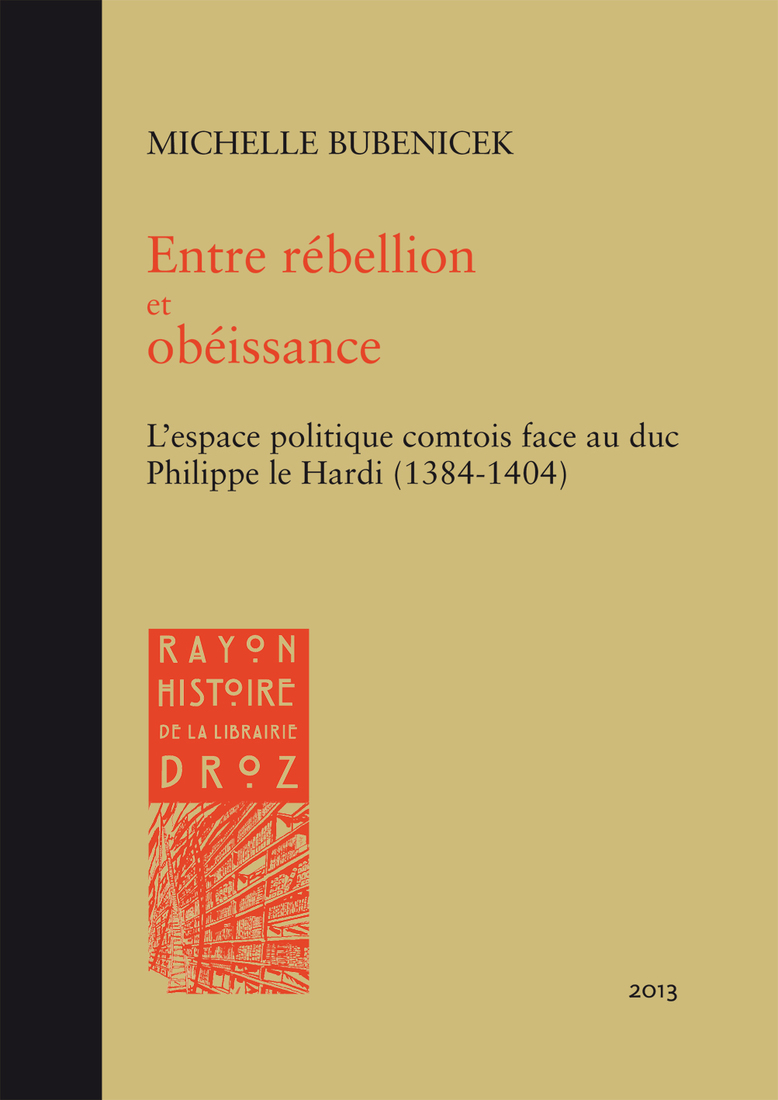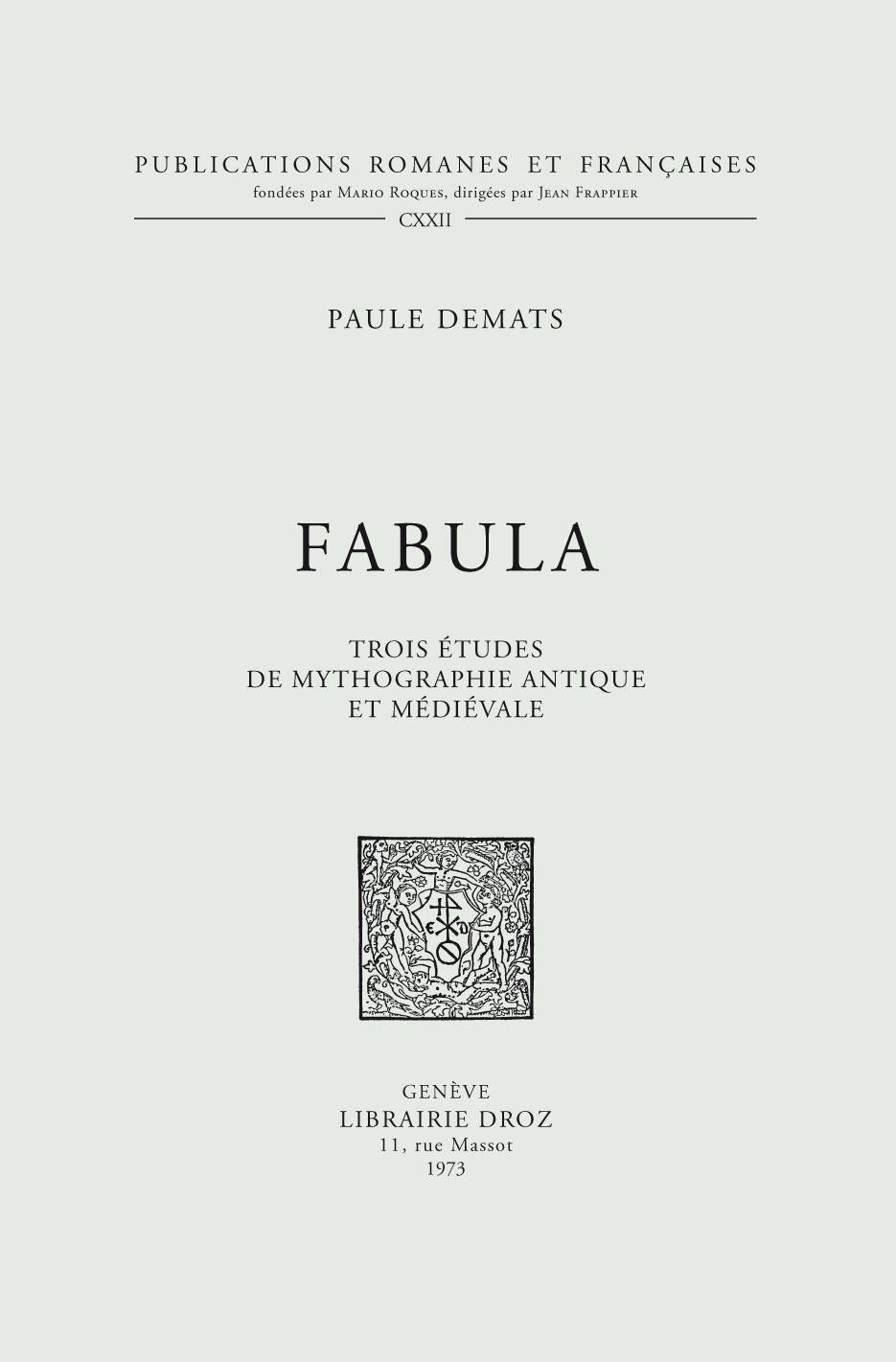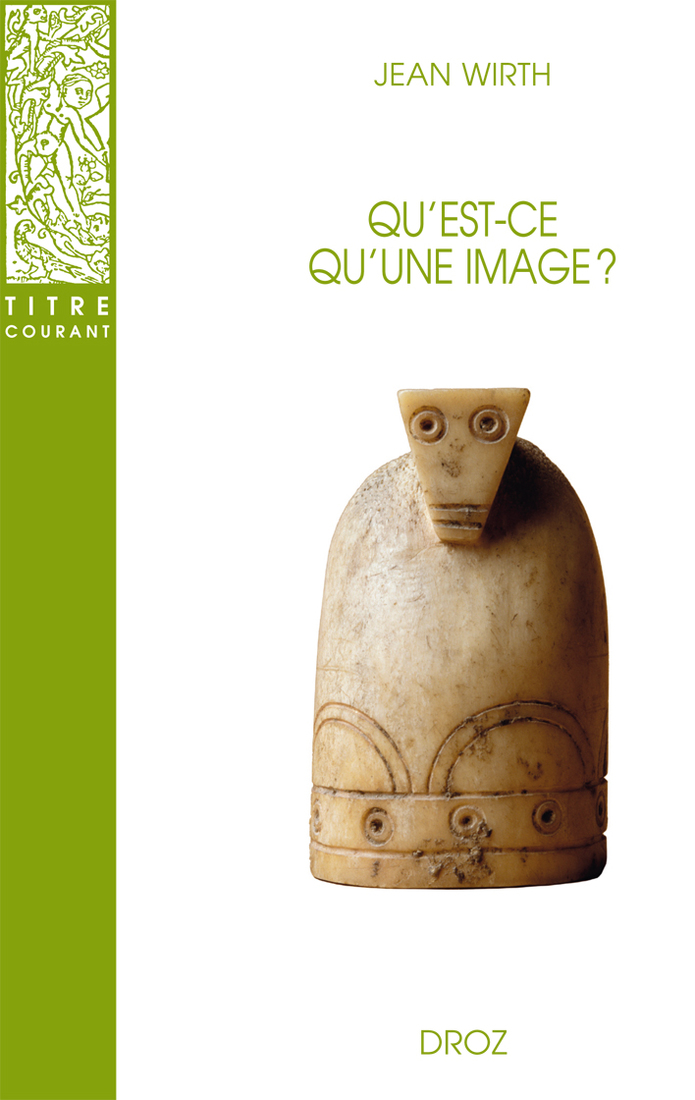Moyen Âge
INTRODUCTION
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE - LES SUJETS COMTOIS : DES REBELLES EN PUISSANCE ?
Le « contenu du paquet de 1384 » : une marche française en terre d’Empire
Eudes IV de Bourgogne et Marguerite de France : des précurseurs de l’action de Philippe ?
Philippe le Hardi et la Franche-Comté : une obsession ancienne ?
PREMIÈRE PARTIE : L’AFFAIRE GUILLEMIN FAGUIER : UNE LÈSE-MAJESTÉ DUCALE
CHAPITRE PREMIER - UNE LÈSE-MAJESTÉ DUCALE (1391-1393)
Aux origines de l’affaire : un meurtre politique
Dire le meurtre de Guillemin Faguier
Une « lèse-majesté ducale »
« ledit de Chalon perseveroit en ladite desobeissance» : Un crime en abîme
CHAPITRE 2 - COMPRENDRE LE CRIME : DEUX VERSIONS CONTRADICTOIRES
Pour le duc : un crime emblématique
Pour Jean de Chalon : une « légitime défense » ?
CHAPITRE 3 - COMPRENDRE LA « SANCTION » : LA RÉMISSION DE JANVIER 1393
Jean de Chalon, tête pensante du meurtre de 1391 : une culpabilité facile à établir ?
Une attitude : du défi à la soumission
Le processus de la grâce ducale
Pourquoi la rémission ?
DEUXIÈME PARTIE : LA SUJÉTION EN QUESTION
CHAPITRE 4 - SE CRÉER SES SUJETS : AUTOUR DE L’ALLEU ET DE L’AVEU
Guillemin Faguier : un individu au statut incertain ?
Deux conceptions de lautorité ?
CHAPITRE 5 - GARDES, SAUVEGARDES ET COMMENDISES : LE DUC ET LES HABITANTS DU VAL DE MORTEAU
De la « commendise » aux « garde » et « bourgeoisie » : une mutation ?
Vocabulaire et chronologie : le cas Morteau
L’enjeu de l’affaire d Val de Morteau : encore la sujétion
L’ordonnance de 1393, solution définitive au problème de la protection ?
Une suite ? Les lettres de 1395 à l’archevêque de Besançon
Epilogue : l’affaire de Labergement-Sainte-Marie en 1404-1406
CHAPITRE 6 - FAIRE DE SES NOBLES DES SUJETS : LA JUSTICE, ENJEU MAJEUR
Essai de géographie judiciaire comtoise : enjeux et rapports de force
Le parlement de Dole : l’outil idéal pour imposer la souveraineté ?
Résistances
Une éducation à l’obéissance ?
CHAPITRE 7 - ÊTRE COMTOIS ET SUJET DU DUC. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L’OPINION COMTOISE
Repérer l’« opinion » comtoise
Sondage d’opinion à l’intérieur d’une zone-frontière
Du silence à la résistance : émergence d’une opinion publique hostile
L’« opinion commune » des terres du sire d’Arlay : une opinion en guerre ?
Une opinion instrumentalisée ?
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE - AU SEIN DE L’ESPACE JURASSIEN, UNE CULTURE DE RÉSISTANCE ?
TROISIÈME PARTIE : FREINS, LIMITES, OBSTACLES À L’IMPOSITION DE LA SOUVERAINETÉ ?
CHAPITRE 8 - LE DUC, L’« ESPACE » COMTOIS ET L’IMPOSSIBLE SOUVERAINETÉ ?
Un nouveau conflit : l’affaire dite « des péages »
Pour une mise en contexte de l’affaire des péages
Derrière le conflit : redéfinition et contrôle de l’espace comtois
CHAPITRE 9 - RÉDUIRE LES ENCLAVES
Besançon : îlot de résistance à la souveraineté
Faire écran au pouvoir de l’empereur
Une « simple » garde ? Nature de la protection accordée en 1386
Maldonne sur le contenu du traité
D’autres enclaves à réduire ?
CHAPITRE 10 - LA NOBLESSE COMTOISE CONTRE LE DUC ?
Un « système » de l’hommage : le duc, la noblesse et le « droit féodal »
Les nobles comtois : une caste encore « privilégiée » ?
La noblesse comtoise : état des lieux et exceptions
CHAPITRE 11 - DISFONCTIONNEMENTS, FAIBLESSES, MANQUE DE MOYENS : LES « LIMITES INTERNES » D’UN SYSTÈME ?
Un prince absent
L’écart entre objectifs affichés et réalité des moyens
Disfonctionnements et incohérences de la méthode ducale ?
CONCLUSION
ANNEXES
SOURCES ÉDITÉES
TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES
CARTES
ÉTAT DES SOURCES
TABLE DES ANNEXES INSÉRÉES AU FIL DU TEXTE
BIBLIOGRAPHIE
INDEX DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX
Construire son pouvoir à la marge : tel est l’enjeu pour le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, devenu en 1384 maître du comté de Bourgogne, terre d’Empire. Dans une perspective d’histoire politique renouvelée, Michelle Bubenicek propose de cerner la nature précise du pouvoir du duc, en posant tout autant la question del’expression de ce pouvoir que celle de sa réception par les sujets du prince. Une analyse conçue comme une contribution originale à la réflexion en cours sur la genèse de « l’État bourguignon », mais peut-être plus encore à la sociologie du pouvoir princier dans son rapport à ceux qui le subissent, les sujets, en particulier les sujets nobles. L’étude précise d’un petit nombre d’affaires emblématiques dont un procès pour « lèse-majesté ducale » - permet ainsi d’éclairer d’une manière nouvelle la construction de la sujétion, au sein de cet espace politique si particulier qui est celui de l’État bourguignon en gestation. Confronté à a rébellion et à des pôles de résistance multiples, le prince parvient-il, en définitive, à élaborer une véritable souveraineté susceptible d’établir et d’imposer à ses sujets comtois les conditions d’une vraie « obéissance » ?
Table des matières
A. Corbellari, Y. Greub, M. Uhlig, « Hommage à Gilles Eckard » ; « Bibliographie de Gilles Eckard » ; L. Barbieri, « De Grèce à Troie et retour. Les chemins opposés d’Hélène et Briséida dans le Roman de Troie » ; J.-P. Chambon, « Ancien occitan Bedos (Flamenca, vers 7229) » ; O. Collet, « Les ‘‘ateliers de copistes’’ aux XIIIe et XIVe siècles : errances philologiques autour du Chevalier qui faisait parler les cons » ; A. Corbellari, « ‘‘Hé ! las, com j’ai esté plains de grant nonsavoir’’ : les aventures d’un mot, de Georges Bataille à Rutebeuf » ; Y. Foehr-Janssens, « Amour, amitié et druerie : grammaire des affinités électives dans le récit médiéval » ; M. Halgrain, « ‘‘Oëz, seignurs, ke dit Marie’’ : autour de quelques indices de “l’affaire Marie de France” qui en leur temps furent oubliés » ; A. Kristol, « Stratégies discursives dans le dialogue médiéval. ‘‘He, mon seignur, pour Dieu, ne vous desplaise, je suy tout prest yci a vostre comandement.’’ (ms. Paris, BnF, nouv. acq. lat. 699, f. 123r) » ; Z. Marzys, « Personne : du nom au pronom » ; P. Ménard, « La philologie au secours de la littérature : le sens d’un vers de Villon » ; P. Nobel, « L’Exode de la Bible d’Acre transcrit dans un manuscrit de l’Histoire ancienne jusqu’à César » ; G. Roques, « Afr. mfr. pautoniere, bourguignon et comtois pautenére, comtois pantenire » ; S. Schaller Wu, « Noire merveille : corneilles et corbeaux nécrophages. D’encre et de plumes » ; P. Schüpbach, « L’expression du souvenir dans les lais de Marie de France » ; R. Trachsler, « Conrad von Orell, lecteur de fabliaux (1830) »; M. Uhlig, « Le texte pour tout voyage : la construction de l’altérité dans le Livre de Jean de Mandeville »; F. Zufferey, « Quand Chantecler s’en allait faire poudrette ».tte ».
Que l’analyse de la littérature puisse être conditionnée par la linguistique, nous le savons depuis longtemps, mais qu’elle entretienne des liens non moins étroits avec la philologie, nous avons parfois eu tendance à l’oublier. Et pourtant la philologie n’est-elle pas soeur de la linguistique ? N’est-elle pas elle-même une linguistique parmi d’autres possibles ? Les temps sont aujourd’hui révolus où l’on pouvait triomphalement opposer à une linguistique synchronique conquérante une philologie adossée à une diachronie réputée obsolète. Car s’il n’est sans doute d’histoire que structurale, il est encore bien plus certain qu’il n’est de structure qu’historique. Lire le texte médiéval, dans toutes ses implications littéraires, à la lumière d’un savoir philologique revivifié et d’une linguistique exigeante, telle a été la leçon que, durant un quart de siècle, Gilles Eckard n’a cessé de professer à l’Université de Neuchâtel. Son enthousiasme sans cesse renouve éclairant plusieurs générations d’étudiants dont aucun n’est resté indifférent à un enseignement chaleureux, empathique et profondément humaniste, a su réconcilier la science de la langue et l’amour de la littérature. Edité par ses élèves et ses proches, le présent recueil entend rendre hommage par l’exemple à Gilles Eckard. La pluralité des sujets n’empêche pas l’unité de l’esprit dans lequel on en a tenté l’approche : du détail linguistique à la totalité textuelle, la philologie, servante moins humble qu’il n’apparaît à première vue, permet à la littérature médiévale de rayonner dans nos consciences d’aujourd’hui.
Cérémonies spectaculaires et hautement symboliques, les entrées solennelles célèbrent et mettent en scène l'arrivée dans une ville d'une figure d'autorité, qu'elle soit ecclésiastique ou politique. A travers de longues processions marquées par des étapes précises dans les rues de la ville au cours desquelles un décor souvent très élaboré est créé, se déploie toute la culture des sociétés urbaines tant sur le plan politique qu’artistique.
Grâce à des exemples inédits puisés, sur plus de trois siècles, dans le Centre-Ouest (Poitou, Aunis, Saintonge) qui regroupe des régions au cœur de l'espace royal français, le présent ouvrage entend témoigner de la richesse et de la diversité de ce rituel. Des documents nombreux et originaux (des journaux de raison aux pièces financières, en passant par les annales, les récits anonymes et autres pièces délibératives des corps de ville), permettent de mieux cerner les multiples enjeux de ces manifestations de souveraineté, et de comprendre comment, entre Moyen-Âge et Renaissance, s'affirme le pouvoir symbolique des États.
Les travaux de Jean Wirth sur l’histoire de l’image médiévale se sont accompagnés dès le début d’une réflexion théorique sur la sémantique de l’image dont il livre les résultats dans ce petit ouvrage. Après avoir montré combien la notion d’image est devenue floue, il reprend le problème là où l’avaient laissé les penseurs du passé, comme saint Thomas, Peirce et Wittgenstein (auxquels il faut ajouter Prieto), puis construit pas à pas une théorie de l’imitation à la fois logiquement cohérente et empiriquement acceptable. Il analyse pour cela la relation élémentaire entre un objet et sa représentation mimétique, sans privilégier l’objet visuel, et dégage la spécificité de cette relation qui diffère considérablement de la dénotation dans le langage articulé, car les unités syntaxiques et sémantiques se confondent. En revanche, les tropes utilisés pour désigner un objet au sens figuré constituent une rhétorique comparable à celle du langage, ce qui permet la mise en image de notions abstraites. Jean Wirth examine ensuite le problème de la représentation des objets auxquels on dénie l’existence, laquelle servait d’argument contre les théories de l’imitation à des auteurs comme Nelson Goodman. Il montre enfin que l’image en soi ne possède aucune performativité, mais qu’elle entre dans des processus performatifs, en déployant une efficacité qui n’est pas de même nature. Ce petit livre rouvre ainsi un débat sur l’image qui était vif dans les années soixante du siècle passé, mais s’était endormi à défaut d’aboutir.
Au terme de trente années de recherches, Charles Bonnet et son équipe du Service cantonal d'archéologie ont mis en évidence la naissance d'une ville par la permanence d'un lieu de culte sur la colline qui domine les rives du lac Léman ct du Rhône, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le premier volume, intitulé Le centre urbain, de la protohistoire jusqu'au début de la christianisation, c'est la permanence cultuelle qui a été décrite, du lieu de refuge de l'oppidum celte, en passant par la «Genua» romaine jusqu’à l'élévation du centre urhain au rang de «civitas», sous l'Empire.
Ce deuxième volume fera découvrir l'adaptation en lieu mémoriel, de la fin de l'administration romaine jusqu'à l'affirmation durable du pouvoir épiscopal. Car la diffusion du culte chrétien a eu ses exigences. Les réformes liturgiques qui s'en suivirent ont nécessité de nombreuses adaptations sous forme de transformations d’atrium, de multiplication de bâtiments cathédraux, d'aménagements de salles de réceptions, de cryptes ou de sépultures, d'installations de baptistères et de rotonde, voire de modifications de nef et d'absides pour arriver à l'établissement de l'édifice romano-gothique actuel.
Après avoir voyagé dans les couches les plus profondes du sous-sol de la cathédrale Saint-Pierre et avoir traversé les différents niveaux d'occupation du noyau urbain, le lecteur y aura perçu les temps forts de la christianisation à Genève. Il aura survécu aux guerres burgondes du Ve siècle, admiré le renouveau artistique carolingien du IXe siècle et participé à la couverture «d'une robe blanche d'églises» dans l'Europe de l'An mil.
Par leur souci de préserver une source documentaire précieuse et de trammettre, par une approche plurielle, des résultats qui ont été mis en relation avec cent quatre-vingt sites archéologiques du hassin méditerranéen, ces deux ouvrages montrent, s'il était encore nécessaire, que l'archéologie raccommode les lacunes du passé, là où les documents écrits manquent.
Le manuscrit 2000 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (XVe siècle), consacré au procès de Jacques d’Armagnac (1477), constitue une source manuscrite médiévale inestimable sur la politique judiciaire de Louis XI. La structure inédite de ce texte révélé dans son éclat originel, la qualité de l’information, la vivacité de la narration, sa destination royale en font un joyau de l’histoire judiciaire. Ce témoignage exceptionnel permet d’éclairer les incriminations, les relations ambigu«s du pouvoir et de la justice, la pénétration longue mais sûre des règles juridiques de la procédure extraordinaire dans la sphère civile et dans la langue vernaculaire.
La première publication de ce document hors-norme intéresse d’abord les pécialistes de la procédure et du droit, mais elle aidera aussi à caractériser un règne qui mit en place, par nécessité, par opportunisme, par pragmatisme, des modes de fonctionnement nouveaux. À ce titre, elle devrait toucher un plus large lectorat.at.
Liberté et audace : pour ce qui est de représenter Dieu, sujet réputé « irreprésentable », l’art du Moyen Age occidental n’a pas son équivalent. Les douze chapitres du présent volume portent pour l’essentiel sur la figure de Dieu dans l’art médiéval, avec quelques débordements nécessaires en amont, vers l’art de l’Antiquité chrétienne, et en aval vers celui de la Renaissance. Après un article méthodologique en ouverture, portant sur les principes mêmes de la représentation artistique de l’Invisible, les chapitres se regroupent autour de trois centres d’intérêt : la figure du Père, les images de la Trinité et enfin des types iconographiques permettant d’observer le phénomène complexe, indissociablement artistique et spirituel, de la « sortie du Moyen Age ».
Ce livre de François Bœspflug, spécialiste de la représentation du Dieu chrétien dans les beaux-arts, renvoie au précédent titre de la même collection sur Les Théophanies bibliques dans l’art médiéval d’Orient et d’Occident. Ces deux livres font une paire et comblent opportunément une lacune. Ils sont comme les deux rives d’où observer un même puissant fleuve pictural, la rive de la peinture des interventions de Dieu dans l’histoire et celle de la constitution d’un lexique atemporel (les motifs) et d’une grammaire (les types) du divin chrétien.